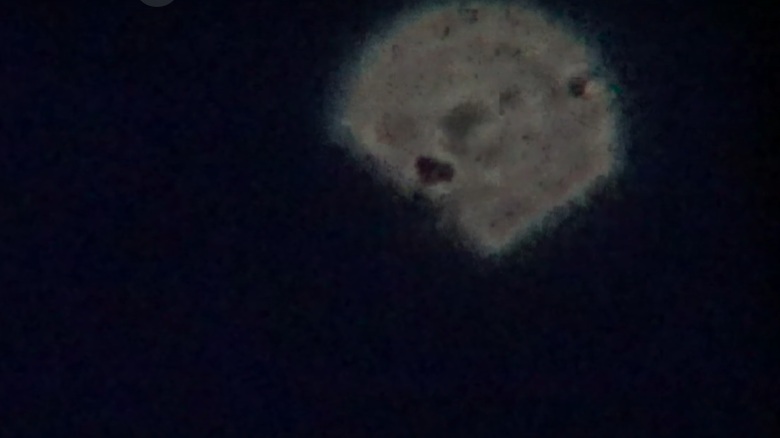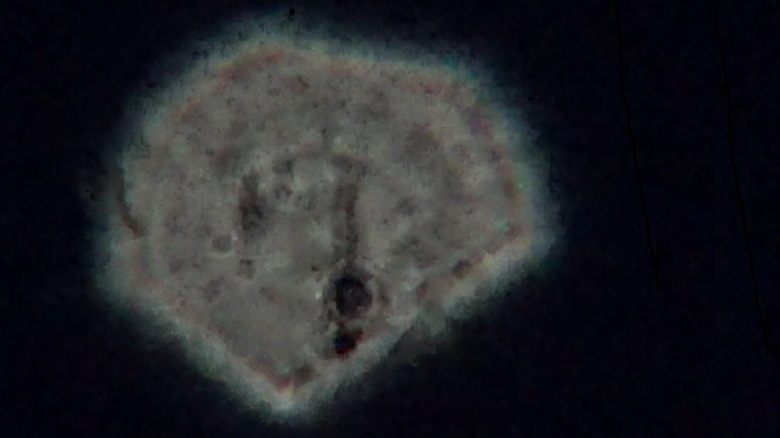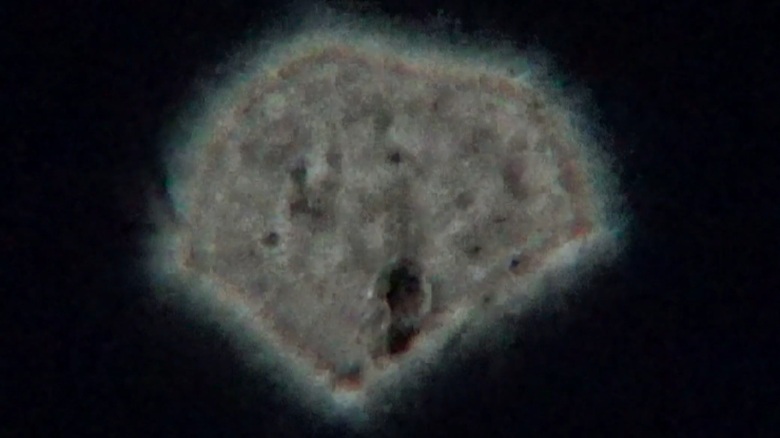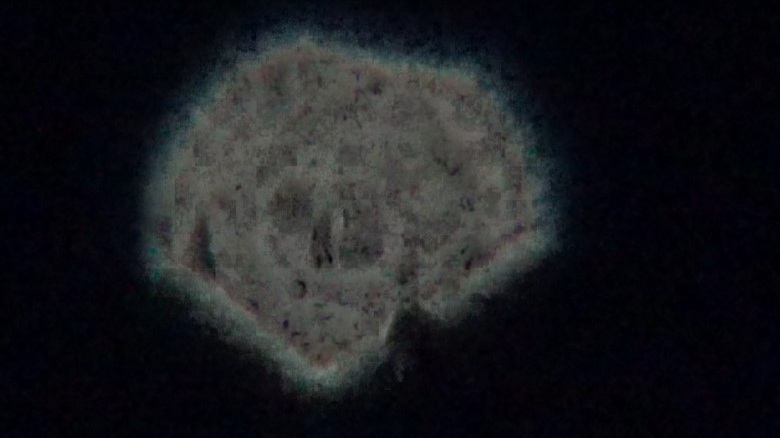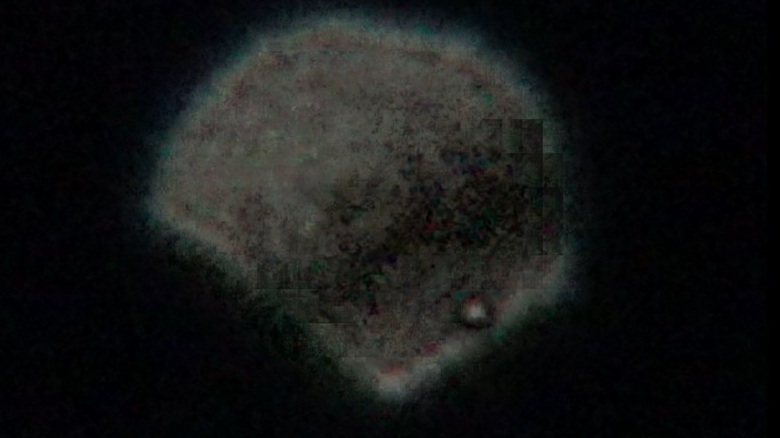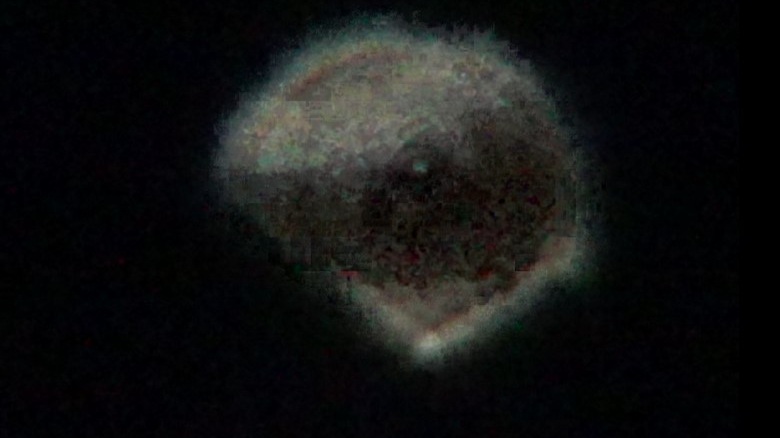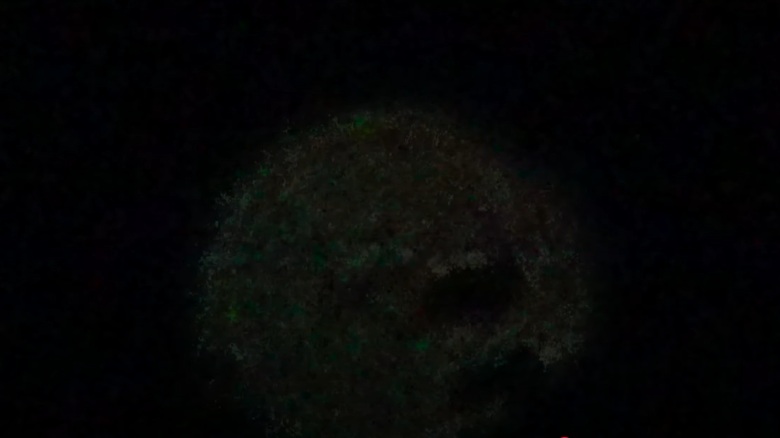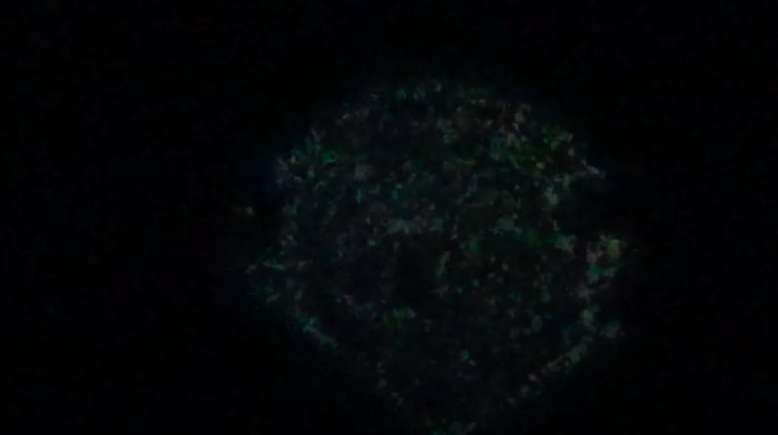Alexander KIRIYATSKIY
UNIVERSITÉ DE ………………..
FACULTÉ DES LETTRES
DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE
Motivation de thèse
dans l’ouvrage "Individu et cosmos" d'Ernst Cassirer et l'origine de
quatre catégories philosophiques
pour obtenir le grade de
Docteur en Philosophie (Ph. D.) présentée publiquement par ALEXANDER KIRIYATSKIY
au Directeur de
Thèse:
………………………………………………………………………………….
1) Base
Ce qui motive ma thèse
présentée à mon admission à l’Université
s’intègre dans la structure d’un examen des détails. Il illustre
les concepts du livre «Individu et cosmos» d’Ernst Cassirer. Notre thèse
dévoile que la Renaissance a formulé la racine de sa philosophie.
Le contexte historique a été analysé sur la base de la
gnoséologie pendant nos études au cours de la maîtrise
à l’Université des Études de Trente. La thèse
systématise quatre chapitres du livre de Cassirer «Nicolas de Cues»,
«Nicolas de Cues et l’Italie»,
«Liberté et nécessité dans la philosophie de la
Renaissance», «La problématique sujet-objet dans la philosophie de la
Renaissance». Ces chapitres présentent l’origine de
quatre nouvelles catégories philosophiques. La thèse
expose ainsi que la forme de la pensée implique la logique, la langue,
le mythe et la réalité créative. Elles s’appuient sur les
traités «Docte ignorance», «Des conjectures» et «De la pensée» de
Nicolas de Cues. De nouveau, Ernst Cassirer
a accepté ces catégories et a dévoilé la
conséquence de leur nouvelle conception. Notre motivation s’appuie sur
l'héritage médiéval qui nous trouve la nouvelle expression
à la Renaissance. Le Moyen Âge et la nouvelle époque se
reflètent dans les quatre catégories de Cassirer
particulièrement.
Plusieurs arguments exposent la
coïncidence des concepts opposés et leur réalisation dans
toutes les sphères du mythe, de la logique, de la langue et de la
réalité. Cette dernière cesse d'être effective et
s'approprie la possibilité humaine de créer. Notre thèse
analyse les formations des conceptions de l’individu, car leur motivation
s'interprète par le fondement philosophique de Cassirer. La même
vie donne les instruments à ces catégories. Ils sont l'âme,
l'esprit, la connaissance et la puissance. Ils contribuent à
préciser le développement de la philosophie
médiévale.
2) Thématique.
Il y a la coincidence des oppositions absolues dans toutes les sphères
à l'époque de la Renaissance. Catégories (mythe, langue,
réalité créative et logique) unies à travers la
forme de l'Individu. Individu dans l’histoire formelle. Frontières des
époques. Relations entre des individus et reconnaissances des nouveaux
instruments (âme, esprit, connaissances et puissance).
3) Cathégories
Les conceptions du temps et de l’individu
représentent une coïncidence des opposés et confirment notre
réalité. Cette dernière s'approprie l'efficacité de
créer. L'homme commence à avoir son propre "moi". Le
développement forme les enseignements des philosophes de la Renaissance
et reconnait l’espace et le temps. Leur moteur conçoit la racine de la
philosophie scientifique de Cassirer. Il y a la relation entre l’indéfinité
(modèle) empirique et infinité (images). Elle conduit vers
l’exclusion réciproque et vers leur union et leur
inséparabilité. Cette loi philosophique fait coïncider les
problèmes de la croyance, de la langue, de la réalité
effective et de la logique,
alors que la nouvelle forme expressive les unit. Les
problématiques des catégories, des objets, des sujets et de leur
circularité consistent dans la compréhension bipolaire de
l’unité des contradictions. Notre objectif est la vérification du
rapport entre les suppositions différentes de Nicolas de Cues et leur
évolution parmi les disciples. Les suppositions effectives se comparent.
C’est la raison pour laquelle, Cassirer coïncide la «transcendance» et la
«participation». Elles impliquent l’altérité éternelle
entre l’idée et l’apparence, entre l’astrologie et la dignité
humaine, etc.. Ces faits produisent l'altérité entre la science
et la croyance. En outre, tous deux dépendent du temps. Nombreuses
théories gnoséologiques dévoilent la nouvelle conception
humaine. Elles motivent d'aller vers le kantisme et de définir le
néo-kantisme de Cassirer. Leurs nouvelles impressions étaient
inexistantes au Moyen Âge.
Comme l’exemple de notre analyse
du Moyen Âge nous dévolons
la resolution de la motivation N10 sous le titre La nouvelle conception s’opposant à la scolastique. Notre
étude de la problématique de cathégories (A) se penche sur la connaissance de Dieu (mythe)
par la bible sans logique et sur l’expression de cette dite connaissance
par la langue immeuble (expressions classiques pour tous), alors que
l'homme dépendait totalement de la réalité, ne
possédait pas son effectivité et affirmait que
l'efficacité humaine ne vient que du diable. Les trois
catégories médiévales rejetaient la reconnaissance du présent
créatif. Le début du Moyen Âge rejette la
catégorie de logique, car le mythe biblique la remplace. En
ce sens, le mythe et l'art (fruit de l'âme), le langage et la
science (puissance humaine), construisent et imposent l'être: ce
ne sont pas de simples copies d'une réalité déjà
donnée, mais les lignes directrices générales du mouvement
de l'esprit, du procès idéel par lequel le réel se
constitue pour nous comme unité et pluralité - comme une
diversité de configurations qui sont, en dernière instance,
unifiées par l'activité signifiante . (Ernst CASSIRER La philosophie des formes
symboliques, Tome I, Intro. Chap. IV Page 39). Cela nous reconduit vers le sens (A) des
catégories, alors que Cassirer souligne que l'homme
médiéval n'a reconnu ni son efficacité ni son
effectivité élémentaire de la logique. L'Individu et
cosmos assimile la logique
et la transcendance, alors que l'une de ces sphères opposées
refuse l'existence de l'autre. L'abîme entre leurs refus fait
apparaître une liaison divine. L'ordre hiérarchique de
l'Être laisse l'espace intermédiaire entre deux mondes
opposés. Ainsi, le néoplatonisme révèle
étape par étape l'Être Divin à ce monde mais aussi
la matérialisation aux idéaux. Le mythe (Dieu) est
opposé à la langue (explication). Afin de parvenir
successivement la perfection, Cassirer transforme l'espace intermédiaire
entre deux mondes en la réalité inconnue et dangereuse.
900 années plus tard, la Renaissance commence à introduire la logique
tuée par Dénis l'Aréopagite dans la même réalité
reconnue. Seule la Renaissance a fait coïncider les mêmes
catégories à travers la forme de l'intuition.
- Notre étude de la problématique des
objets (B) présuppose l'origine de la scolastique sur la
frontière entre l'Antiquité et le Moyen et son évolution
médiévale, selon l'Individu et cosmos. La scolastique a
assimilé l'héritage de Dénis l’Aréopagite
philosophe byzantin du VIe siècle et a
réalisé son but. Les philosophes du Moyen Âge classique,
comme Jean Scot Erigène, Albert le Grand et Thomas d'Aquin, ont réinterprété la
hiérarchie céleste et ecclésiastique de Dionysos
Aréopagite. Avant la Renaissance, leur scolastique était
idéalisée et rejetait le développement de la pensée
philosophique. Les idées de Nicolas de Cues n'ont pas traversé la
limite médiévale des enseignements traditionnels. En outre, elles
leur ont donné une nouvelle forme décrite par avance.
Notre étude de la problématique des sujets
(C) illustre Nicolas de Cues qui donne
l'autre direction à la hiérarchie céleste et
ecclésiastique de Dénis l'Aréopagite. Dénis
l'Aréopagite développe la tautologie jusqu'à sa propre vision
renouvelée de l'Univers. Il réinterprète les concepts de
Maitre Eckhart et de Pseudo-Denys Aréopagite. Nicolas de Cues
conçoit le rapport entre leurs enseignements de manière
très distincte et différente en s'appuyant sur la
coïncidence des concepts opposés. Cette dernière illustre l'utilisation de la hiérarchie
d'Aréopagite dans nos quatre catégories philosophiques.
CAB) La circularité des problématiques reliées présente le sujet-individu identifié
à Nicolas de Cues qui revient aux catégories et crée ses
nouveaux objets à travers la coïncidence de nos catégories
opposées (CAB). Ainsi, le cardinal prolonge le chemin classique des
philosophes médiévaux comme Jean Scot Erigène, Albert le
Grand et Thomas d'Aquin. En
outre, son enseignement est absolument opposé à la tâche
médiévale de défaire les essences antiques de nos quatre
catégories. L'homme médiéval formule sa conception de Dieu
sur les concepts chrétiens, juifs et antiques. Dénis
l’Aréopagite écrit ses traités Des noms divins et De la
hiérarchie céleste et ecclésiastique et les
transforme en sources d’enseignements médiévaux, sur lesquels
s'appuient les trois philosophes mentionnés plus haut. Dénis
l'Aréopagite sépare, par ses traités, la croyance et la
science (logique), et nous pouvons dire que Pseudo-Dénis détruit
le rapport entre le sauvetage de l'âme et l'esprit spéculatif de
l'hellénisme. Ce philosophe byzantin confond aussi les relations entre
les catégories et leurs instruments. Au Moyen Âge, l'esprit
s'incarne dans la réalité sans efficacité et la langue
de la Byzance s'est réorganisée à travers la nouvelle puissance
de la poésie rimée. Pendant l'Antiquité, cette
dernière n'existait pas. Pseudo-Dénis l'Aréopagite
proclame le processus successif d'unir l'homme à Dieu et de
détruire l'illustration de l'intelligence.
(Hèris o
pedôs paghà) Au VIe
siècle, de nombreuses rimes linguistiques étaient, par
leur puissance, les empreintes des poètes du Proche-Orient, car
leur état de l'âme a déterminé la nouvelle croyance
(Dieu). L'objet se transformait en sujet et produisait son opposition. En
outre, aucun objet ne sera jamais sujet. En Byzance, la connaissance
asiatique a déplacé la logique hellénique et l'esprit
de l'humiliation a établi les dogmes de la réalité
obscure:
(Hèris o
patrôs morfà)
(Hèris o
pedôs kripis)
(Hèris o
patrôs sifrighis)
(Hèris o pedôs kartos)
(Hèris o patrôs kallos)
Ktibat bgalyatà (Vardessèn,
poète juif baptisé en Syrie au IVe ou au Ve
siècle après J. Cr.). La critique classique a
persuadé les poètes de croire que la rime et les vers rythmiques
ne soient qu’un trait négatif comme dans la poésie de Virgile.
shihat bkas yatà
mirat bkariatà
tmi hat bset
latà
Christ qui nous nourrit
tué en vendredi,
donne le paradis,
ressuscite et dit.
Áspice \\cónve\\xó
nu\\tántem \\póndere \\múndum, À partir du premier siècle av. J.-C. jusqu'au IXe
siècle, la rime était crée en rapport avec les
particularités philosophiques de Cassirer. Les traits de sa philosophie
présentaient uniquement le rôle implicite dans ses traités.
Les particularités de Cassirer se produisaient causalement et ne
déterminaient que l'insuffisance de sa professionnalité. Son
individualisme devait se diffuser dans la matière stipulée, car
l’individu ne devait pas avoir son caractère. De même, la
première rime n’a trouvé ni ordre fixe ni soutenance dans la
poésie byzantine. Pendant la Renaissance, la réalité
créative a démontré que l'absence de la rime et les
vers syllabiques ont perdu leur validité. La couleur blanche est devenue
noire. La rime et le rythme se sont transformés en priorités
poétiques. Au contraire, au XVe siècle, leur
absence ne se considère que par l'insuffisance. De même, les
particularités de Cassirer illustrent maintenant son génie. Notre
thèse compare ce dernier avec la rime sur la frontière entre
l'Antiquité et le Moyen Âge. Cassirer stipule
particulièrement la constitution des dogmes du Moyen Âge et leur
évolution historique. L’innovation des catégories philosophique
et leur reconnaissance, par Cassirer, devient la cause de notre thèse.
Elle nous reconduit des catégories philosophiques aux objets. En 1938,
son livre Jean Pic de Mirandole
à la recherche de l'histoire des idées de la Renaissance reconnaitra que l'Individu et cosmos
était soumis au crédo de Cassirer et idéalisait la
résistance contre l'expérience médiévale. Cassirer
croit que la nouvelle conception ne refuse jamais l'opposition
mentionnée entre l'âme et l'Univers, car Nicolas de Cues les unit
simultanément par leur coïncidence. L’histoire dévoile que
l'époque médiévale ne reconnaissait aucune approbation
concrète. 4) Méthodologie A) Deux aspects Notre recherche a les analises de cinq formes distinctes (de l’exploration
(a), de la généralisation (b), de l’individualisation (c), de
l’appréciation (d) et de la contemplation (e)). De plus, il existe deux aspects des analyses
des œuvres philosophiques. B) Herméneutique Il y a un concept non évident (de
toutes les formes, des types et des aspects). Il accompagne toujours les
méthodes générales et subjectives. Ce concept ouvre une
nouvelle manière de l’examen. Les catégories de Cassirer
expliquent les influences médiévales sur la révolution
philosophique de Nicolas de Cues. Notre travail fait coïncider les
collaborations singulières des autres chercheurs avec son
interprétation herméneutique de la Renaissance. Les tendances
évidentes établissent les proportions entre deux natures de
Cassirer. La première est extérieure. La deuxième se cache
à l'intérieur de ses particularités implicites. De
même, notre thèse doit accepter la même motivation, pour la
quelle, Cassirer attire l'attention sur l’absence du centre de l'Univers
à la fin du Moyen Âge. Pour quelle raison ses catégories
philosophiques reflètent l’absence du minimum et du maximum dans
l’espace cosmique? Cette coïncidence des concepts opposés unit
Cassirer et Nicolas de Cues. Les oppositions absolues dévoilent un seul
chemin vers la supposition implicite que le Globe Terrestre se meut. Elles
exposent l’existence potentielle des droites infinies des côtes des
triangles infinis. La nouvelle conception
de la Renaissance dans l’ouvrage
"Individu et cosmos" d'Ernst Cassirer" La motivation de notre thèse est le
rapport entre les catégories philosophiques d'Ernst Cassirer et son
traité "Individu et cosmos". Ce dernier examine la formation
de l'individu sur la frontière qui sépare le Moyen Âge de
la Renaissance en Europe. Cette frontière tente d'éviter toutes
les autres catégories sauf la langue (expression), le mythe
(Dieu et croyance), la réalité créative et la logique.
L'«Individu et cosmos» d'Ernst Cassirer étudie les racines de ces quatre
conceptions. Il détermine l'instrument de chaque catégorie.
Cassirer voit dans l'âme l'instrument de Dieu. De même que l'esprit
sert à la réalité créative, la connaissance
à la logique et la puissance à la langue. Le XXI siècle a
besoin de la nouvelle reconnaissace des principales caractéristiques: projets,
objets et méthodes d'Ernst Cassirer, car ces derniers devient
obligatoirement hermétiques. Leur particularité enferméee
les systématise et expose la coïncidence historique des oppositions
absolues sans proportion. Le dernier idéaliste expose que les autres
façons des recherches ne conduisent pas à un résultat
créatif. La matière de l'"Individu et cosmos" justifie
cette analyse enfermé de Cassirer. De même, ses autres travaux
confirment que son hermétisme refuse les autres catégories et
leurs rapports aux autres instruments. Notre recherche examine le début
de la connaissance précise. Elle dévoile que l’instrument de la réalité
créative conduit à Kant et, à travers la nouvelle langue,
le nouveau mythe et la nouvelle logique, conçoit le néo-kantisme
de Cassirer. Les concepts de «Liberté et
nécessité dans la philosophie de Renaissance» mènent
Cassirer au XX et au XXI siècle. L'actualité est bien davantage
abstraite et chaotique qu’à la Renaissance comme le Moyen Âge. Les
qualités de notre compréhension ne sont que les relations entre
l’individu et le cosme fermé. La motivation de notre thèse est
fondée sur la nouvelle compréhension. Ernst Cassirer
présente ses discours scientifiques et religieux sur la base des
connaissances, à partir des dogmes médiévaux de Nicolas de
Cues jusqu'au XXI siècle. Aujourd'hui, notre réalité
créative laisse accepter l'évolution de la pensée humaine
plus profondément qu'en 1927, car plusieurs traits particulières
du XX siècle étaient inconnus avant la deuxième guerre
mondiale et après. Projet bref par les motivations suivantes Motivation et but.
L'expérience historique. – Sources de nos problématiques.
Démonstrations objectives. La recherche de l'actuation – méthode,
particularités et limites. L'essence de notre travail. Biographie
brève du dernier idéaliste allemand. Méthodologie
d'Ernst Cassirer son début et son devoir de souligner toujours un chercheur
neutre. Racines de la philosophie particulière de Cassirer. CORPUS de notre
thèse. La scolastique et la nouvelle
expression A) La coïncidence des termes
opposés 1) Nicolas de Cues fondateur allemand
de la nouvelle philosophie italienne 2) La nouvelle expression unit les
gentils et les chrétiens 3) Les temps séparent
l'Académie et le passé 4) L'expression des sentiments et les
rapports avec le Moyen Âge 5) L'opposition concrète entre
l'homme médiéval et l'homme de la Renaissance 6) La naissance du microcosme
à l'intérieur du nouvel homme A) La coïncidence des
oppositions physiques et spirituelles 7) La nouvelle conception de la
Renaissance B) Les racines historiques de la
coïncidence des théories opposées 8) L'impossibilité de
déterminer la Perfection Infinie 9) La grande motivation et la
gradation sans raison des sphères en s’approchant de Dieu 10) La nouvelle conception
opposée à la scolastique 11) La coïncidence
médiévale des concepts opposés de Platon et d'Aristote 12) La cosmologie
médiévale de l'Univers fini 13) Les concepts opposés
contre leur coïncidence C) La première tentation de
connaître Dieu 14) La limite de la dimension et son
absence 15) Le fini et l'infini n'ont aucune
proportion 16) La nouvelle coïncidence des
concepts opposés de Platon et d'Aristote 17) La destruction de la logique
traditionnelle 18) Dieu est en dehors des
déterminations humaines 19) La puissance mystique de la
vision intellectuelle 20) L'illustration de l'intelligence
et son union avec Dieu D) La relativité de la
nouvelle conception 21) La stabilité contre les
changements 22) L'opposition entre la raison
éternelle et l'illusion proportionnelle 23) Deux types de frontières et
leur stabilité 24) Disparation théoriques des
frontières mentionnées 25) Les opposés s'absolutisent
afin d'avoir la coïncidence réelle 26) La première conjecture de
l'infini relatif 27) La même conception au XXIe siècle 28) Les rapport entre les sphères
empiriques et l'Être Absolu Principes de Nicolas de Cues dans
la pratique A) Dieu et ce monde 29) Deux cosmes et les erreurs
d'Aristote 30) L'égalités de tous
les objets auprès de l'Infinité Divine B) Le premier pas vers le
cosmopolitisme universel 31) Les appartenances divines et
mondaines 32) Tentation d’unir toutes les
croyances 33) La conception de Dieu à
l'intérieur des limites humaines 34) Nicolas de Cues et la formation
du concept d’ «individu» 35) L'homme médiéval et
celui-ci de la Renaissance 36) La vision de la nouvelle
réalité 37) La puissance limitée de ce
monde C) La théorie de la
relativité de Nicolas de Cues et la nature 38) Le développement de la
nouvelle conception philosophique D) La nature et la nouvelle
puissance de l'esprit 39) La nouvelle compréhension
des ordres 40) La source de l'esprit humain E) L'homme du XXIe siècle
opposé à l'individu de la Renaissance 41) Les traits
médiévaux de l'homme contemporain 42) La masse de gent
indifférente opposée à l'individu 43) Le changement des valeurs F) La source de
l'évaluation 44) Deux états de l'Être
45) L'erreur de la Renaissance et le
retour au passé 46) La coïncidence entre le
Moyen Âge, la Renaissance et le XXème
siècle de Cassier 2ème CHAPITRE: Nicolas de
Cues et l'Italie En dehors des limites temporaires de
Nicolas de Cues A) Les influences directes et
indirectes 47) Les 150 ans après Nicolas
de Cues 48) Le concept de "devenir
reconnu" et l’appartenance à la nationalité italienne 49) La liste des noms ne devant
être reconnus 50) L'évidence des empreintes B) La guerre entre des
commentateurs et 51) Sous le masque de
l'héritage classique d'humanité
52) La relation réel des
imitateurs avec la classique 53) La nouvelle sagesse 54) Les partisans indirects de la
nouvelle conception 55) Les racines historiques de
l'union entre la nature et l'esprit humain 56) La victoire de la science
précise 57) Le "livre divin" de la
nature et les dogmes bibliques 58) L'évolution de la conscience
des opposés Influence sur le retour à la
tradition A) Sous la peur de l’innovation 59) L'absence des concourants
opposés 60) La nouvelle vision opposés
61) La balance instable entre la
science et les dogmes religieux 62) La victoire de la croyance B) L'Académie platonique de
Florence 63) La confiance mystique
opposée à nature 64) Pic de la Mirandole
"phénix de l'esprit" 65) Les désirs, les traits et
les possibilités de l'âme 66) Ficin et la beauté de
l'âme 67) L'absence de l'hiérarchie
à l'intérieur de l'espace intermédiaire 68) L'image intelligible à
l'intérieur de l'homme 3ème CHAPITRE:
Liberté et nécessité dans la philosophie de la
Renaissance A) L'essence de la fortune 69) La dépendance humaine 70) Le désir de
l'indépendance et son image 71) L'opposition absolue de
l'indépendance et du bonheur et son fruit B) La coïncidence des
opposés, de la philosophie et des beaux-arts 72) La particularité de la
Renaissance des inventeurs originaux 73) Les idées plus claires que
la vies, le destin et la force de la volonté C) Le retour aux racines
médiévales 74) Les liaisons entre la
liberté et la nécessité 75) L'imitation des façons
antiques 76) Des nouvelles formules plastiques
de compromis D) L'approbation conditionnelle du
concept de "moi" et son absence 77) La première tentation de
contredire le destin 78) Les modifications du rôle
humain E) Le danger de
l'indépendance à moitié 79) La première tentation ne
s'abaisse jamais 80) L'expérience traditionnelle,
le courage des innovations et leur coïncidence 81) Le danger de
l'idéalisation par sa vérité partielle 82) La particularité de la
Renaissance 83) Lorsque le culte substitue
remplace Dieu F) Nécessité de
l'empreinte 84) Dépendance du Moyen
Âge au XVe siècle
85) Introduction des nouveaux
instruments 86) Nécessité de
l'efficacité créative 87) Notre appartenance et notre
aliénation 88) Relativité de notre
aliénation et but des empreintes 89) Guerre infinie entre le bien et
le mal 90) Rapports au Moyen Âge 91) Nouvelles essences des titres
antiques 92) Nécessité du devoir
humain 93) Nouvel homme et nouvelle espace 94) Animal ou Dieu Humain 95) Possibilités de l'homme G) Pas à la Renaissance
hors de l'Italie 96) Catégories philosophique de Charles Bovelles
Térras\\qué trac\\túsque
ma\\rís cae\\lúmque pro\\fúndum;
Áspice,\\ véntu\\ró
lae\\tántur ut \\ómnia \\sáeclo.
Ó mihi \\túm lon\\gáe
mane\\át pars \\última \\vítae,
Spíritus\\ ét quan\\túm sat
e\\rít tua \\dícere \\ fácta.
Regardes moi // comme je // meus les // ponts de tel // monde
Les terres // et les // ondes des mers // que soit // le ciel pro// fonde
Regardes, cha //cun ren//contre heu//reux le nou//vaux siècle.
Ou laisse moi // que la // vie me con//duise comme // cette ère
dernière
Par ta puis//sance // et par com//bien mon esp//rit laisse
pré//dire.
OVNI. Au-dessus de la Suisse. Conthey. Photos:
6.03.2025, 26.2.2025, 1.03.2025, 19.3.2025,
3.3.2025, 31.3.2025, 25.04.2025,10.4.2025